Pourquoi certaines langues n'ont pas de mot pour « gauche » ou « droite »
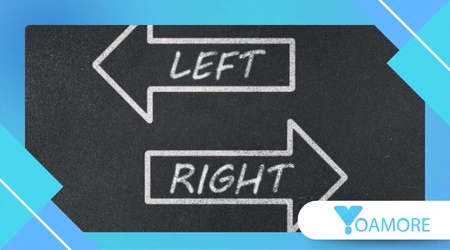
Dans certaines langues, il n’y a pas de mot pour « gauche » ou « droite », un fait qui en dit plus sur le cerveau et la culture humaine que nous pourrions le supposer.
Annonces
Loin d’être une simple curiosité linguistique, cette absence offre une perspective convaincante sur la façon dont les gens conceptualisent l’espace, interagissent avec leur environnement et forment une identité collective.
Grâce à une combinaison de preuves anthropologiques, de sciences cognitives et d’observations du monde réel, nous explorons comment cet écart directionnel remodèle la perception.
Cet article décompose les implications culturelles, neurologiques et fonctionnelles de ce phénomène, en intégrant des exemples réels, des preuves statistiques et des avis d’experts.
Vous trouverez également un tableau récapitulatif sur les systèmes linguistiques mondiaux et deux ressources externes fiables pour une exploration plus approfondie.
Annonces
Une perspective globale : toutes les langues ne pensent pas de la même manière
L’anglais et la plupart des langues occidentales s’appuient sur des termes spatiaux égocentriques : « gauche », « droite », « devant » et « derrière ».
Ces directions varient selon la position et l'orientation de l'orateur. Mais ce modèle n'est pas universel.
Dans plus d’un tiers des langues connues dans le monde, les gens n’utilisent pas de mot pour « gauche » ou « droite » du tout.
Au lieu de cela, ils utilisent des directions cardinales (nord, sud, est, ouest) ou des repères topographiques comme montée/descente.
Par exemple, les locuteurs mayas tzeltals au Mexique utilisent « en montée » et « en descente » pour décrire des lieux, même à l’intérieur.
De même, les aborigènes Guugu Yimithirr d'Australie se réfèrent exclusivement aux points cardinaux, en disant des choses comme : « Votre côté sud est sale », quelle que soit l'orientation de l'orateur.
De tels systèmes géocentriques nécessitent une conscience constante du paysage et de la direction, intégrant profondément la géographie dans la cognition.
Les recherches menées par le scientifique cognitif Stephen C. Levinson, affilié à l’Institut Max Planck, soutiennent cette hypothèse avec des données solides.
Il a découvert que les individus issus de cultures linguistiques géocentriques surpassent souvent les autres dans les tâches de mémoire spatiale et d’orientation, démontrant ainsi que ces systèmes directionnels entraînent le cerveau différemment.
Lire aussi : Les punks de Tijuana : micro-résistance par la musique et le style
Nécessité environnementale et fonctionnelle

Pourquoi certaines cultures rejettent-elles la direction relative ? La réponse réside dans le contexte. Dans des paysages vastes ou à topographie variée, un langage directionnel fixe est non seulement plus précis, mais aussi essentiel à la survie.
Pensez aux communautés vivant dans des déserts ouverts, des régions côtières ou des chaînes de montagnes. Dans ces environnements, dire « marcher vers l'est, passer les dunes » est plus pertinent que « tourner à gauche après l'arbre ».
Dès la petite enfance, les locuteurs de langues géocentriques intériorisent l'orientation, telle une boussole. Dans leur cas, le corps n'est pas le point de référence, mais le monde.
Ce changement dans le cadre cognitif commence par la manière dont les anciens donnent des instructions sur la manière dont se déroulent les jeux et les rituels.
Il ne s’agit pas ici de complexité linguistique mais plutôt d’adaptation fonctionnelle.
La terre enseigne la langue. Dans les sociétés urbanisées et structurées, cependant, les orientations égocentriques s'avèrent plus efficaces.
Les bâtiments, les grilles et la signalisation rendent les positions relatives fiables et évolutives. C'est ainsi que l'évolution linguistique s'adapte au contexte humain.
+ Les règles de grammaire les plus étranges du monde entier
Tableau : Utilisation mondiale des systèmes de référence spatiale
| Type de référence spatiale | Pourcentage de langues mondiales | Caractéristiques principales |
|---|---|---|
| Cardinal (géocentrique) | 38% | Utilise des directions fixes (N, S, E, O) |
| Relatif (égocentrique) | 30% | Utilise l'orientation personnelle du corps (gauche, droite) |
| Mixte/Topographique | 32% | Utilise l'élévation, les indices de terrain (en montée, au bord de la rivière) |
Selon le Atlas mondial des structures linguistiques (WALS), le système cardinal domine dans les langues parlées en Océanie, dans certaines parties de l'Afrique et en Amérique centrale.
Cerveau et comportement : comment le langage façonne la pensée
Les expériences menées par la linguiste cognitive Lera Boroditsky auprès de locuteurs aborigènes ont révélé des résultats étonnants. Ces personnes pouvaient s'orienter avec une précision absolue, même à l'intérieur ou dans des villes inconnues.
Un participant a pu indiquer avec précision les points cardinaux dans l’obscurité la plus totale, une capacité rarement trouvée chez les utilisateurs de langages égocentriques.
Cette intelligence spatiale n'est pas innée ; elle se cultive par l'usage quotidien de termes géocentriques. Par conséquent, l'absence d'un mot pour « gauche » ou « droite » conduit à une meilleure sensibilisation à l’environnement.
Les orateurs doivent toujours savoir où se trouve le nord ou où se trouve la montagne par rapport à leur corps.
Plutôt que d’être moins compétents, ils font preuve d’une forme d’intelligence qui passe inaperçue dans nos sociétés axées sur les mesures.
Cela suggère que le langage ne décrit pas simplement la pensée ; il peut en réalité reprogrammer la capacité du cerveau à traiter l’espace.
+ La langue Pirahã : une tribu qui n'a pas de mots pour les nombres
Une expérience de pensée : GPS ou boussole
Pensez-y de cette façon : utiliser des directions relatives, c'est comme naviguer avec un GPS, en mettant constamment à jour votre itinéraire en fonction de votre position.
En revanche, utiliser des systèmes cardinaux revient à porter une boussole : vous devez toujours savoir où vous êtes dans le monde.
Les deux systèmes fonctionnent. Mais ils guident votre attention différemment. Un utilisateur de GPS se concentre sur son environnement immédiat, tandis qu'un utilisateur de boussole pense globalement.
Ce cadre mental, façonné par le langage, change la façon dont les gens vivent non seulement le mouvement, mais aussi la mémoire, la narration et la planification.
Donc, quand une langue manque d'un mot pour « gauche » ou « droite »ce n’est pas une absence, c’est une vision du monde alternative.
Mémoire, apprentissage et impact à long terme
La manière dont les enfants acquièrent ces systèmes spatiaux influence bien plus que la simple direction.
Des études montrent que les enfants élevés dans des langues à base cardinale développent une meilleure mémoire à long terme lorsqu'ils sont testés sur des tâches spatiales. Pourquoi ? Parce qu'ils construisent des cartes mentales basées sur des points de référence stables.
Ce modèle s'étend à d'autres domaines. Dans la narration, par exemple, les orateurs décrivent souvent les événements en utilisant des termes cardinaux pour exprimer le temps et le mouvement.
« Il marcha vers le nord dans la tempête » ne véhicule pas seulement des images, mais un ancrage précis dans l’espace et le temps.
Même l'artisanat et les rituels traditionnels s'inscrivent dans cette philosophie. Dans de nombreuses sociétés amérindiennes et aborigènes, les cérémonies et les bâtiments sont alignés selon des directives sacrées, et non selon un emplacement arbitraire.
Cela révèle une vision du monde dans laquelle l’orientation n’est pas seulement pratique, mais sacrée.
Deux cas réels, naturellement intégrés
Chez les Guugu Yimithirr, un enfant pourrait entendre : « Passe le sel au nord de ton assiette » plutôt que « à ta droite ».
Cela n'affecte pas seulement la grammaire, mais définit aussi la perception. De même, à Bali, des instructions comme kaja et kelod sont ancrés dans la religion, faisant référence à la montagne et à la mer.
Ces directions structurent les maisons, les rituels et même les salutations quotidiennes.
Ces deux exemples prouvent que lorsqu’une culture manque d’un mot pour « gauche » ou « droite », il acquiert tout un cadre de signification et de coordination basé sur quelque chose de plus grand que l’orientation individuelle.
La perspective technologique : ce que l'IA et la conception UX peuvent apprendre
Les technologies modernes reflètent de plus en plus la pensée occidentale. Les applications GPS, les outils de réalité augmentée et même la robotique adoptent souvent une approche égocentrique. Mais les développeurs constatent désormais des limites à l'adaptation de ces outils à une utilisation mondiale.
L’intégration de la logique géocentrique dans l’IA pourrait offrir des améliorations en matière de navigation autonome, en particulier sur les terrains éloignés où les marqueurs fixes comptent plus que les repères relatifs.
Les concepteurs UX repensent également le langage directionnel dans les applications multilingues pour garantir des interfaces intuitives.
Cette prise de conscience culturelle n'est pas seulement éthique, elle est aussi pratique. Elle nous rappelle que tous les utilisateurs ne raisonnent pas en termes de « gauche » ou de « droite ». Vous pouvez explorer cette intersection plus en détail grâce à une analyse détaillée disponible sur Revue technologique du MIT.
Ce que nous perdons dans la traduction
Ironiquement, l'anglais ne parvient souvent pas à traduire ces nuances spatiales. Lorsque les locuteurs autochtones adoptent les langues dominantes, ils abandonnent souvent les cadres géocentriques, perdant non seulement du vocabulaire, mais aussi des siècles de savoir culturel.
Cette perte linguistique affaiblit la conscience écologique et la préservation du patrimoine.
Cela réduit également l'éventail des modèles cognitifs à disposition de l'humanité. Soutenir l'éducation multilingue et préserver les langues autochtones ne concerne pas seulement la culture : il s'agit de préserver des outils mentaux alternatifs.
Réflexions finales : les mots qui changent le monde
L’absence d’un mot pour « gauche » ou « droite » Cela n'indique pas un manque. Cela évoque une intelligence différente, celle qui perçoit le monde non pas à travers le prisme du moi, mais à travers sa géographie immuable.
Ces modèles linguistiques remettent en question les hypothèses, élargissent la diversité cognitive et enrichissent notre compréhension de l’adaptabilité humaine.
À mesure que la mondialisation se poursuit, honorer ces systèmes spatiaux offre plus que de la curiosité. Cela offre une compréhension, une humilité et un appel à préserver la manière dont le langage façonne la pensée.
Questions fréquemment posées
1. Est-ce que toutes les cultures sans « gauche » et « droite » utilisent les points cardinaux ?
Pas nécessairement. Certains utilisent des références topographiques comme « en amont » ou même des indications sacrées basées sur des points de repère.
2. Cela affecte-t-il uniquement la langue ?
Non. Cela influence la cognition, la mémoire spatiale, l’architecture, les rituels et même le développement de l’enfant.
3. Ces systèmes linguistiques sont-ils en voie de disparition ?
Malheureusement, oui. Avec la domination des langues mondiales, de nombreux systèmes spatiaux traditionnels sont menacés.
4. Cela a-t-il des applications pratiques en dehors de la linguistique ?
Absolument. L'intelligence artificielle, la conception de l'expérience utilisateur et même l'éducation environnementale peuvent bénéficier d'une réflexion géocentrique.
